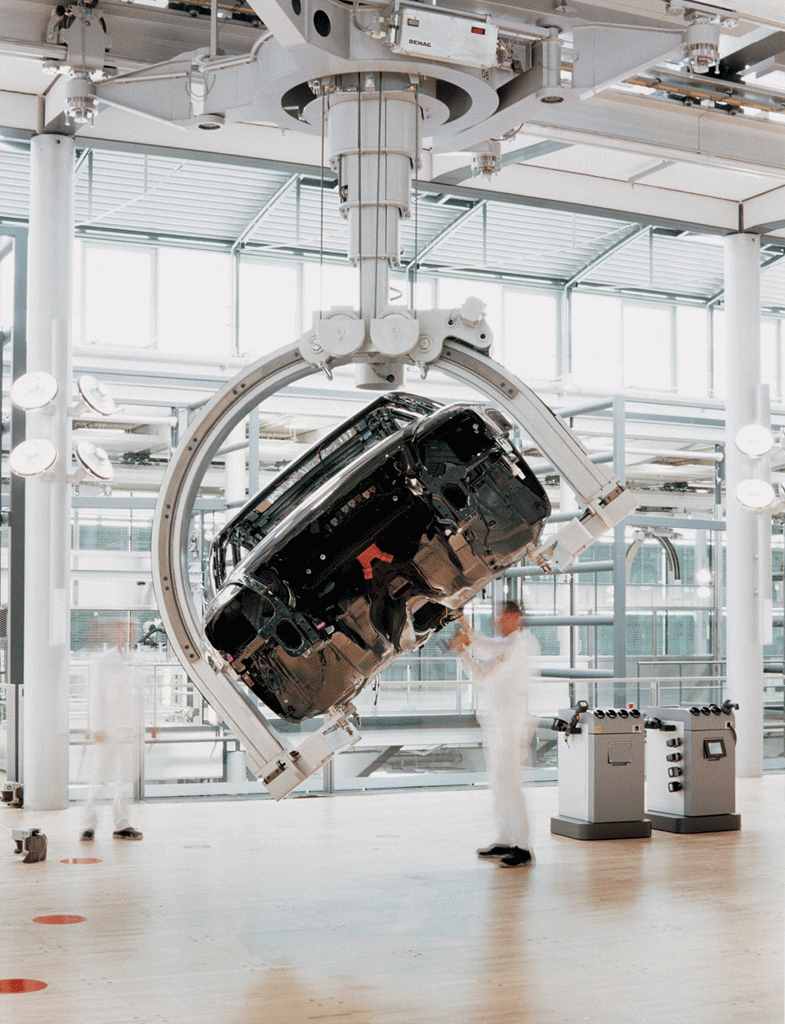Agriculture et architecture, trajectoires communes 2—3
Deuxième temps du dossier d’Archizoom Papers - revue en ligne itinérante, fruit d’un partenariat entre AA et Archizoom, la galerie de l’EPFL – consacré ce mois-ci à l’exposition Agriculture and Architecture: Taking the Country’s Side, sous le commissariat de Sébastien Marot, philosophe et professeur d’histoire environnementale. Retrouvez toutes les précédentes éditions d'Archizoom Papers en suivant ce lien.
Prendre le parti de la campagne.
Trajectoires communes en agriculture et en architecture
En place depuis la fin du mois de février à l’EPFL et momentanément fermée en raison des mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19, l’exposition Agriculture and Architecture: Taking the Country’s Side, avait été dans un premier temps produite dans le cadre de la Triennale d’Architecture de Lisbonne en 2019.
Pour Archizoom Papers, le journaliste Christophe Catsaros s’est entretenu avec le commissaire de l’exposition Sébastien Marot, philosophe et professeur d’histoire environnementale à l’École d’architecture de la ville et des territoires de Paris-Est, et professeur invité à la Graduate School of Design de Harvard et à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.

Tandis que la première partie de l’entretien, s’attachait à retracer l’historique des relations entre agriculture et industrialisation, à l’aune des progrès scientifiques, mais aussi à celle des conflits politiques, il est maintenant question de l’évolution de la permaculture, comme contre-modèle de cette dérive agricole technico-scientifique.
Christophe Catsaros : Un des chapitres de l’exposition se penche sur des zones de résistance, des territoires montagneux en Asie, qui se seraient mis à l’écart de la société et du progrès.
Sébastien Marot : Cette thèse que nous évoquons dans l’exposition a été développée par James C. Scott qui était un historien spécialisé dans l’agriculture, ainsi que fermier et anarchiste. Il s’est penché sur ce qu’il a appelé la Zomia, une région boisée et montagneuse, à cheval entre plusieurs pays, en Asie du Sud-Est, et qui fait cinq fois la taille de la France. Ce qui surprend dans son étude, c’est l’idée que l’autonomie de ces populations dispersées ne serait pas tant le fait de leur nature « primitive » que d’un mouvement délibéré et récurrent de fuite, pour échapper au contrôle et à la mobilisation des États-rizières qui se sont en priorité établis dans les plaines et les vallées.
Comme Scott l’a bien montré dans Homo Domesticus, les premiers États se sont construits autour de la culture intensive de céréales, d’abord parce que ces dernières se conservent bien, mais aussi parce qu’elles ont un cycle de croissance annuel, prévisible et cadencé. En d’autres termes, ces céréales sont éminemment contrôlables et taxables. Il n’y aurait pas eu de villes sans cette captation, sans l’inspecteur des taxes et le contrôle biopolitique que la ville exerce sur la campagne. L’État naît de l’asservissement de populations autour de la culture de céréales annuelles : maïs, blé et riz. La culture céréalière est consubstantielle à la constitution des cités.
Scott redonne ainsi vigueur à la thèse de Pierre Clastres qui voyait dans bien des sociétés dites primitives non pas des « sociétés sans État », c’est-à-dire restées veuves de cette évolution, mais des « sociétés contre l’État », c’est-à-dire organisées de telle façon que les caractéristiques de l’État (comme la division sociale et hiérarchique du travail) n’apparaissent pas. Ces populations vivaient en retrait non pas parce qu’elles n’avaient pas connu l’État, mais précisément parce qu’elles cherchaient à éviter son emprise biopolitique.
CC : L’histoire coloniale a, elle aussi, son pendant agricole.
SM : En effet. Les conséquences sur l’agriculture de la colonisation des « nouveaux mondes », précèdent les effets de la révolution industrielle. Là aussi on observe certains phénomènes plus ou moins concomitants, entre les XVe et XVIIIe siècles, et qui prennent la forme, pour le monde agricole, de l’apparition des enclos. En Europe, la fin de l’openfield, des communs et des droits de glanage, c’est-à-dire la généralisation de la propriété exclusive, coïncide avec l’intensification de l’économie de marché et sa façon de configurer les pôles urbains.
Les pratiques du Moyen Âge qui consistaient à cultiver en commun ont disparues sous la pression de la division des sols. C’est à la même période que se sont établies les plantations coloniales, dont la taille et les besoins en main d’œuvre ont favorisé un retour de l’esclavage. Les historiens laudateurs de la révolution urbaine n’auront de cesse de dénigrer le Moyen Âge. Pourtant le servage et l’esclavage sont très différents. Le servage n’est pas l’assujettissement total de l’animal humain, qu’est l’esclavage. Le servage est plus nuancé et compose avec les droits coutumiers.
La véritable entrée dans l’économie de marché commence autour des plantations coloniales, avec l’appropriation exclusive des sols et des travailleurs par des compagnies maritimes. Et bien sûr, cette situation se répercute dans les territoires européens. Les riches laboureurs et les aristocrates cherchent à appliquer les mêmes méthodes afin d’augmenter les rendements, au détriment de l’économie vivrière qui prévalait jusqu’alors. C’est le contexte de la politique des enclos. Je ne suis pas un historien de la question, mais il y a là une coïncidence qui est parlante.
CC : La permaculture apparaît dans l’exposition comme un contre-modèle à la dérive agricole techno-scientifique.
SM : Nous soulignons en effet l’importance de ce mouvement, même s’il peut être considéré comme marginal face aux pratiques courantes de la révolution verte, c’est-à-dire l’industrialisation de l’agriculture à l’échelle mondiale. Ce qui m’intéresse dans ce mouvement, c’est la profondeur de sa réflexion philosophique et pratique, dont témoigne le grand livre de David Holmgren, Permaculture : Principes et pistes d’action vers un mode de vie soutenable. Holmgren définit la permaculture comme une philosophie de projet appliquée à la production nourricière et résiliente dans un contexte de descente énergétique. Il s’agit donc d’une philosophie pratique orientée vers la production locale, et destinée à répondre à une situation de crise qui se profile dans les années 1970, celle de la fin des énergies fossiles. Ce concept de descente énergétique, il l’emprunte à un écologiste, Howard Odum, auteur de Environment, Power and Society (1971). Dans cet ouvrage, Odum s’applique à décrire les écosystèmes en fonction de leur profil énergétique. Sa méthode consiste à penser les transformations de l’énergie, du soleil aux plantes, dans l’industrie et jusque dans l’information, qui en serait la forme la plus dense et raffinée.
Les travaux systémiques d’Odum ont énormément influencé Holmgren. Ce qu’il retient surtout, c’est la façon dont les sociétés agrariennes, et plus précisément leur structuration territoriale, ont été transformées par l’arrivée d’énergies denses et non renouvelables comme le charbon, le gaz et le pétrole. Dans cette perspective, il n’y aurait pas de métropole aujourd’hui s’il n’y avait pas eu d’énergies denses. C’est la possibilité de transport d’énergie dense qui favorise les concentrations. Odum explique que la descente va immanquablement se produire une fois le pic des énergies fossiles atteint, et qu’aucun substitut ne pourra vraisemblablement compenser la quantité d’énergie massivement utilisée au cours des deux derniers siècles.
Permaculture One, publié en 1978 par Bill Mollison et David Holmgren, est donc, pour l’essentiel, le mémoire de 3e année d’un étudiant en design environnemental nourri par Odum, par le premier rapport au Club de Rome, et par tout le mouvement environnementaliste, et qui se demande comment répondre aux défis du déclin énergétique. Le modèle qu’il développe se situe au carrefour de l’agriculture, de l’architecture de paysage et de l’écologie. En somme, la permaculture est une quête de systèmes autonomes dans un contexte de déclin. Il s’agit d’une pensée profonde s’efforçant de définir des systèmes techniques post-industriels, qui trouvent leur application dans le champ de l’agriculture, mais pas seulement. La permaculture concerne potentiellement bien d’autres domaines, et constitue une mine de leçons et de réflexions pour des disciplines de projet comme l’architecture ou l’urbanisme.
CC : La permaculture serait une quête de techniques pour un monde post-industriel.
SM : Dans Permaculture One, Holmgren et Mollison renvoient à ce propos à un critique d’architecture, Colin Moorcraft, qui était étudiant à la AA School of Architecture de Londres au début des années 1970 (tout comme Rem Koolhaas). En juillet 1972, dans un numéro d’AD où il tenait une chronique régulière, genre « eco-tech », Moorcraft avait publié un article très documenté et argumenté, « Designing for Survival », qui faisait notamment un bilan critique de la révolution verte, des pertes de savoir qu’elle induisait et de l’exode rural qu’elle générait. En conclusion, cet article estimait qu’une technologie post-industrielle devrait reposer sur trois principes : la coopération, l’intégration et la flexibilité. Autrement dit, il s’agissait de développer des technologies qui 1) ne soient pas des boîtes noires, mais qui soient au contraire adaptables et réparables par leurs usagers (flexibilité), 2) limitent au maximum les intrants et les externalités négatives en bouclant leurs cycles (intégration), et enfin 3) optimisent les relations et interactions de leurs composantes (coopération). Un système technique coopératif, écrivait Moorcraft, est un système « où chaque élément remplit plusieurs fonctions, et où chaque fonction est assurée par plusieurs éléments ». On a là une sorte d’alter-fonctionnalisme, radicalement différent du fonctionnalisme moderniste dont le modèle était la machine et dont l’efficacité reposait sur la séparation des fonctions. Ici, le modèle est plutôt l’écosystème, dont la résilience tient justement à la diversité et aux interactions mutualistes de ses composantes.
Au fond, la permaculture s’est dès le départ définie comme la mise en œuvre et l’approfondissement de ce programme alter-fonctionnaliste. L’exemple simple de la coopération qu’elle recherche est celui de la poule, qui ne fait pas que des œufs, mais produit de la chaleur et des plumes, fertilise par ses déjections et en grattant le sol, etc. La vision qui consiste à réduire la poule à sa production d’œufs est en soi très pauvre. Dans un système permaculturel, l’enjeu est de situer et d’intégrer cet « élément » (la poule) dans un agencement qui permette de satisfaire au mieux ses besoins, et de profiter des nombreux services qu’elle peut rendre à l’ensemble. C’est un exemple simple, qui peut fonder un système de réflexion et une philosophie pratique basées sur la complémentarité.

Retrouvez les précédentes éditions d'Archizoom Papers en suivant ce lien.